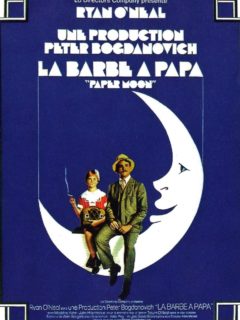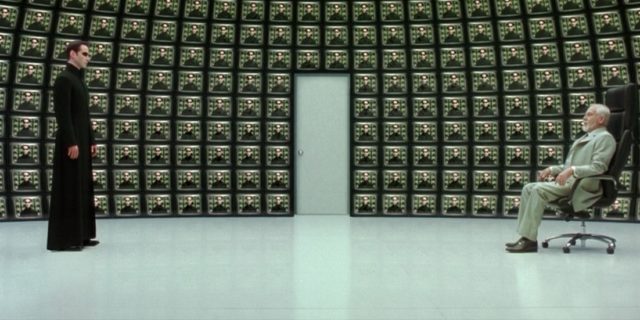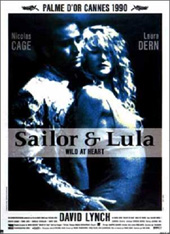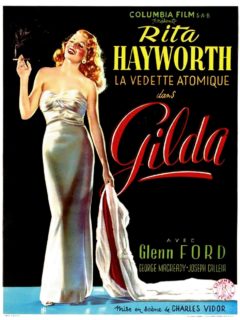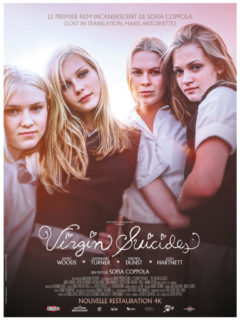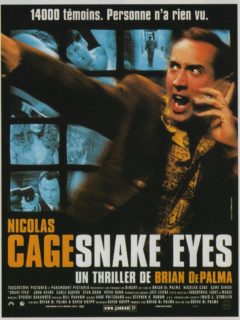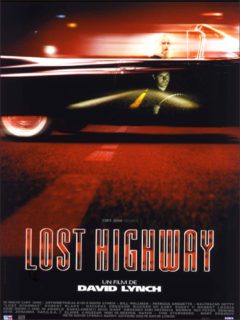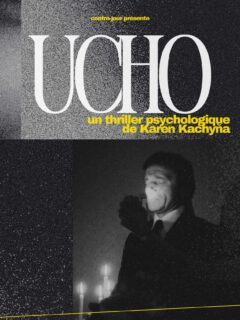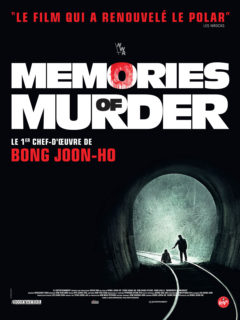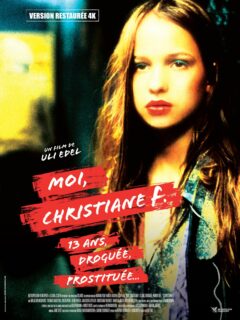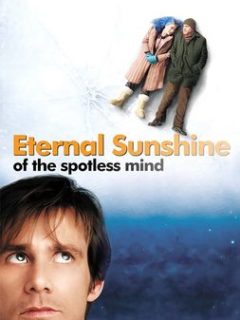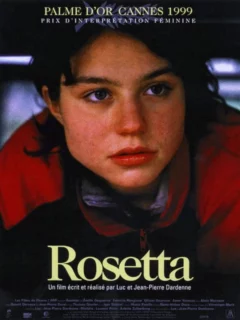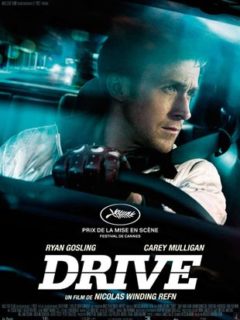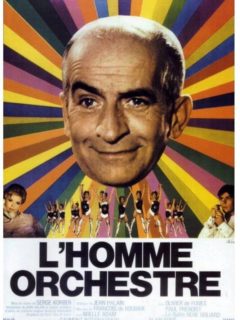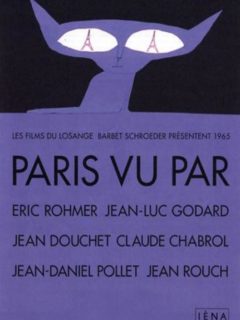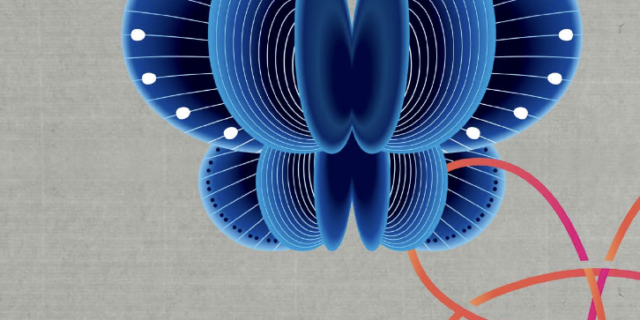Il ne faut qu’une poignée de plans à Peter Bogdanovich pour nous rappeler le cinéma de John Ford. Midwest, années 1930. Enterrement mutique, granularité du noir & blanc, paysages de nature américaine à perte de vue, ligne d’horizon qui bascule de haut en bas du cadre, entre encrage des personnages dans le sol, la terre où est descendu le cercueil de la défunte, et ciel solennel qui l’appelle à lui.
Ford, marotte ultime d’un réalisateur aussi cinéphile de Bogdanovich, adressée directement par un documentaire (Réalisé par John Ford, sorti en 1971 et enrichie de nouveaux entretiens en 2006) et dont le cinéma et la vision de l’Amérique faisait déjà la souche spectrale de La Dernière Séance (1971), premier large succès et peut-être unique œuvre culte du cinéaste. Un sillon qu’il regagne après un détour plus pétillant dans la comédie slapstick à la Howard Hawks On s’fait la valise, Docteur ? (1972), dont il retrouve pour La Barbe à papa l’acteur Ryan O’Neal. Nouvelle muse du cinéaste qui jouera aussi dans son Nickelodeon (1976), corps athlétique et gauche entre James Stewart et Cary Grant, ici sous les traits de Moses Pray, combineur roublard et ridicule, habile charmeur mais grand gamin qui va se retrouver fiché de la jeune orpheline de neuf ans Addie (jouée par la fille de l’acteur, Tatum O’Neal) que sa famille distante attend tout là-bas à Saint-Louis. L’ami de la famille, qui a connu la mère il y a de nombreuses années (neuf, devine-t-on), s’embarque donc avec la gamine renfrognée dans un trajet en sauts de puces de bourgades en bourgades, au fil des dollars à chiper ici ou à rafler là, entreprise à laquelle Addie ne tardera pas à se prêter avec réussite.
Un authentique road movie et buddy comedy où la légèreté du duo, toujours en prise de bec ou complicité filoute, se déploie durant un trajet en plein cœur du pays. Loin des côtes, en pleine Grande Dépression, Bogdanovich filme comme dans La Dernière séance cette Amérique ouvrière, laissée pour compte, dans toute sa chair rurale et paupérisée. Les conditions économiques ne cessent de poindre, au détour d'un dialogue (avec Imogene, jeune domestique noire s'accrochant faute de mieux à une patronne ingrate), d'une péripétie (voler de l'alcool de contrebande à un trafiquant), ou dans le compte systématique des pièces & billets récoltés lors des divers larcins. Une toile de fond omniprésente, ou plutôt une profondeur inextinguible ; pas de trucage par transparence pour faire défiler le décor lors des scènes en voiture, mais des prises de vues réelles des routes qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Et sur leurs bords, des caravanes de travailleurs exilés de leur terre croisés comme des mirages, des rappels violents à la réalité, tout droit sortis des photos de Dorothea Lange ou, évidemment, des Raisins de la colère (1940) de Ford. Une Amérique en voie de disparition qui fait retour et dans laquelle le duo d'arnaqueurs tente de maintenir malgré l'évidence une insouciance salvatrice.
Décorum fordien donc, mais Bogdanovich est aussi le disciple d’Orson Welles, dont il réinvestit également plusieurs figures. C’est par son truchement formel - grande profondeur de champ, grands angles, contre-plongées - qu’il fait exister dans le fond des plans le décor et l’horizon économique des Raisins de la colère, ou construit des cadres dans la profondeur qu’il peut tenir, souvent en plans-séquences discrets, pour laisser s’y déployer des scènes quotidiennes et familiales qui n’auraient pas démérité chez Ford. Les perspectives exacerbées et caméras basses se fondent en un filmage à hauteur d’enfant, point de vue à la fois garant de l’amusante légèreté du film et plus susceptible à la sensation d’écrasement par le ciel surplombant dans l’image. Entre deux dans lequel baigne tout le film, aussi espiègle que tragique, profondément doux-amer, racontant dans le même geste la survivance de l'insouciance et son anachronisme intrinsèque dans son époque. Ce que fera presque encore plus littéralement le film suivant de Bogdanovich, Daisy Miller (1974), suivant la trajectoire d’une jeune aristocrate à la fin du XIXème siècle qui refuse de se plier aux us des bons mœurs de l’époque.
Si Daisy Miller se termine par un enterrement, La Barbe à papa commence par là. Signe peut-être d'un film moins pessimiste que le suivant ou que La Dernière séance, mais qui pour autant ne manque pas un de ces plans finaux dont Bogdanovich a le génie. Le plaisir de l'hommage ne dure qu'un temps, l'innocence s'efface. C'est le final funèbre et vaporeux de Daisy Miller, plus tard le héros de Saint Jack (1979) se perdant dans la foule au fond d'un port de Singapour, ou, prophétique dans son premier film La Cible (1968), une dernière voiture abandonnée sur un parking de cinéma drive-in. Le regard dans le rétroviseur, vers Ford, Welles, Hawks et tous les autres, fusse-t-il aussi enthousiaste que Addie courant vers le tracteur miteux de Moses dans l'un des derniers plans de La Barbe à papa, évite peut-être surtout de faire face. Face aux étendues désertiques et surtout désertées, vers lesquelles le père et sa fille inavouée s'élancent tant bien que mal dans le plan final, cadre large face à une route serpentant vers le lointain, sachant qu'ils courent, eux aussi, vers leur disparition, maître mot des fins chez Bogdanovich. Parce que le pastiche, la reprise, le retour de cette humanité du cinéma classique, est par essence un geste de rétention, un regard mélancolique, une envie de revivre ce cinéma d’un instant passé. N’oublions pas que si la Barbe à papa est effectivement dégustée par Addie durant une foire, elle prend seule sa photo devant la Paper Moon (titre original du film, désignant ici le décor en papier d’un photographe), n’arrivant pas à convaincre Moses de poser avec elle, côte-à-côte, occasion manquée qui teinte tout le film de son parfum.
Rappeler cette peinture de l'Americana déçu des années 1930, c'est rappeler dans le même temps l'idéal perdu du cinéma qui l'avait mis en scène. Si Bogdanovich était, jusque récemment, le dernier des cinéphiles, ou du moins l'un des plus rares et précieux, alors ses personnages sont les récipiendaires de sa foi illusoire dans l'entreprise de faire survivre ce qui a forgé sa cinéphilie. Hommage, et donc inévitablement mélancolie, c’est là l’”élégie” dont parle Jean-Baptiste Thoret à l’égard de Peter Bogdanovich, qui a fini, en ce début d’année 2022, par disparaître lui aussi, probablement par le fond d’un cadre, aussi humblement que ses personnages. Anachronique résigné, passionné intemporel.