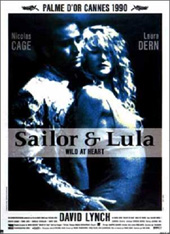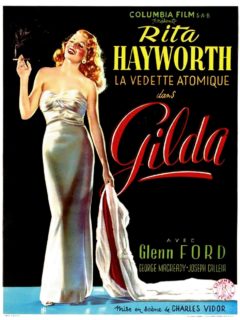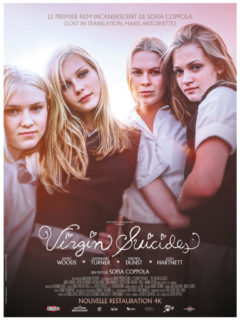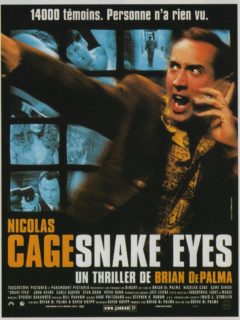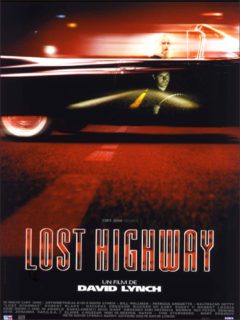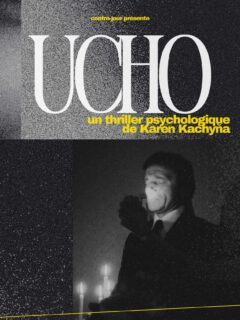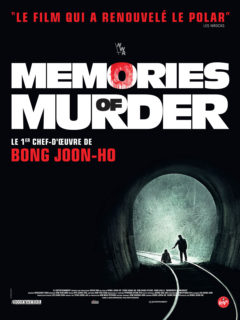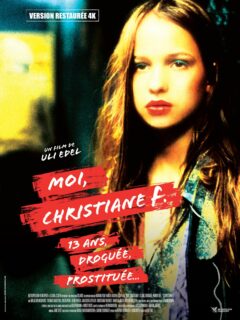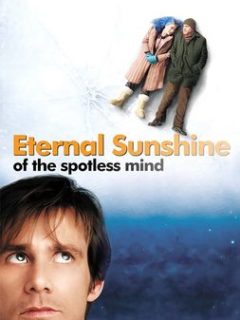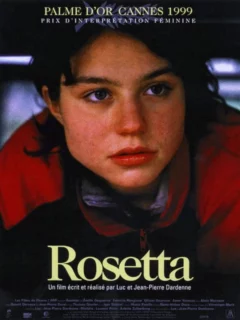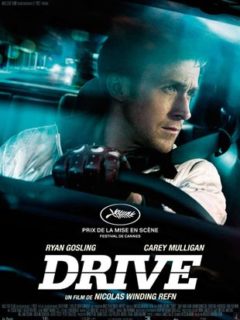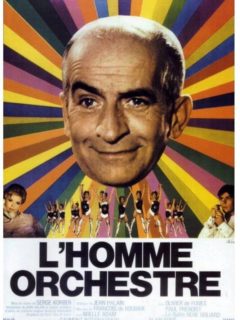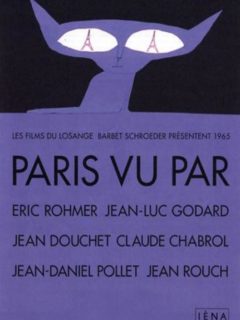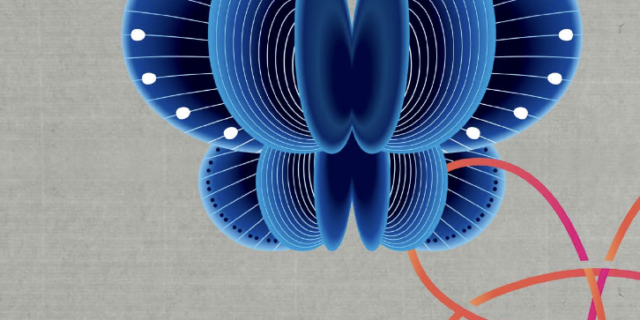Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? (BLADE RUNNER, Ridley Scott)
Profession Reporter
Édition 2021-2022
Quand il réalise Blade Runner en 1982, Ridley Scott a déjà deux longs-métrages derrière lui : Les Duellistes, à l'influence kubrickienne marquée, ainsi qu'Alien, le 8ème passager, qui révolutionne complètement la science-fiction, en y introduisant un parfum de terreur, et instaure surtout un thème fétiche de Ridley Scott : l'intelligence artificielle. Ash, officier scientifique, se révèle en effet être un androïde et évalue la survie de l'équipage secondaire face à l'importance de la mission. Dès lors, Alien dépasse le «simple» film d'horreur et atteint presque un discours social, les membres de l'équipage, plus ou moins des camionneurs prolétaires de l'espace, étant déshumanisés et sacrifiés à la croissance des multinationales. Virage que ne fera qu'accentuer Blade Runner.
Pour autant, Blade Runner s'inscrit d'abord dans une certaine rupture face aux précédents films de Scott. Là où Les Duellistes s'inscrivait pleinement dans le film historique et dans le sillon de Barry Lyndon et où Alien était surtout un projet du scénariste Dan O'Bannon et une œuvre de pure science-fiction, Blade Runner se démarque par son aspect protéiforme : à la fois science-fiction dystopique, film noir, et même tragédie antique avec un rapport œdipien au père, le film multiplie les influences (dès sa musique, mélange de jazz, de vieux standards, de synthé et même de chants égyptiens), jouant d'archétypes.
Ainsi Rick Deckard, le détective sinistre et torturé, une sorte de néo-Humphrey Bogart, côtoie la femme fatale Rachel dans un univers futuriste de ruelles sombres et pluvieuses, le tout sous une photographie expressionniste, fait d'ombres et de lumières. A ceci près que Scott détourne les codes et les renverse allégrement: la femme fatale aguicheuse est ici une androïde au corps mécanique et à l'attitude froide, et le détective lui-même se voit déconstruit, puisqu'il se révèle à la fin n'être, au lieu du justicier tentant de rétablir l'ordre dans la jungle urbaine, qu'un androïde comme un autre, un pion de la société, banal.
Le rapport au cinéma, aux influences, de Blade Runner est alors conflictuel, à la fois hommage et déconstruction, et symptomatique de l'univers dystopique de Blade Runner. Car dans ce futur proche, et maintenant éloigné en la lointaine année 2019, le lien plus globalement à la culture témoigne d'une société crépusculaire, où se mêlent passé et futur, civilisations, dans une ambiance tokyoïte moderne (que ne reniera pas Lost in Translation plus tard, montrant à la fois jardins bouddhiques et salles d'arcade assourdissantes). Les bas-fonds de la ville et ses néons arborent un gigantesque panneau publicitaire Coca-Cola, mais aussi des échoppes japonaises, tandis qu'en hauteur se dressent de gigantesques pyramides qu'on pourrait dire égyptiennes. On y trouve même également la chambre de Tyrell, style Empire.
Dans ce mélange architecturale de cultures, tout à l'horizontal, se développe alors une autre influence : Metropolis, pionnier de la science-fiction de Fritz Lang, qui pourtant n'aura jamais été aussi primitif dans son adaptation du mythe biblique de la tour de Babel. Metropolis, une ville qui se construit tout en horizontalité elle aussi, rabaissant les pauvres et élevant les riches au-delà des nuages, pour tenter de se soustraire à la société infernale: une croissance sans fin qui mène finalement à la catastrophe. Blade Runner développe cette même thématique, avec ses riches industriels qui s'étendent dans le faste des pyramides opposées à la misère de la ville plus basse, sa brume et sa pluie sans fin, mais sans la fin cathartique de Metropolis ; Scott filme au contraire un monde crépusculaire dans une lente agonie, rythmée par les notes futuristes et étirées des synthés de la bande-originale composée par Vangelis, et dont la pluie continue ne serait pas sans évoquer un Déluge éternel.
Ainsi, Blade Runner prend l'allure d'une sorte de chant du cygne d'une société courant à sa perte, accompagnée d'une atmosphère sinistre jusqu'à sa scène finale, où l'ombre de la mort plane. Futuriste, le film s’apparenterait alors à une dystopie qui alerterait de la fin de l'Homme : simplement, intemporel comme on l'a vu dans son mélange d'influences, Blade Runner dépasse également cette apparence et un contexte écologique contemporain, plus propre à Soleil vert par exemple, et s'inscrit dans une posture mythologique totale. Ainsi, le répliquant Roy Batty ressemble de toute évidence à un Œdipe moderne, tuant son père, le créateur, Tyrell, tout comme celui-ci est bien un nouveau Prométhée, créant la vie. Plus encore, Batty cite le poète William Blake et apparaît alors comme un ange déchu, une sorte de Lucifer: “Fiery the angels fell…”.
Ressort alors dans cette mythologie moderne la question philosophique principale que posait le roman de Philip K. Dick, et son titre, à l'origine du film : les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Dans cette phrase, certes principalement un bon jeu de mot, réside également quelque part l'essence du film. En effet, on ne demande pas si les androïdes rêvent, mais bien s'ils rêvent de moutons électriques : quelque part, leur humanité, bien qu'oxymorique, n'est pas nié, puisqu'ils sont conscients de leur artificialité et pensent (comme lorsque Pris cite Descartes, “Je pense donc je suis”), bien au contraire elle est même évaluée supérieure à celles d'humains comme le personnage Sebastian, qui s'accompagne de pantins mécaniques, ou la foule grouillante des rues de la ville. Cependant, dans ces “moutons électriques” réside un doute presque spirituel, un oxymore révélateur: mécaniques, ces androïdes sont peut-être aussi sensés que nous, peut-être aussi humains, mais ne sont-ils pas uniquement capables de penser selon ce qui leur a été donné, programmé ? Rêver un mouton électrique comme reflet de soi, l'Homme électrique. Tel Rick Deckard (dont le nom n'est pas sans rappeler encore une fois le philosophe), dont le rêve de licorne ne serait q'une implantation, factice. Autrement dit, les androïdes peuvent-ils être dotés d'une âme, de raison et de spiritualité, et même d'un autre point de vue, le sommes-nous réellement, ou nos raisonnements et rêves ne sont-ils pas eux-mêmes guidés par la société? La cruauté du film est bien alors encore une fois de montrer la spiritualité des androïdes Nexus-VI, qui tentent de se libérer de leurs chaînes, avec notamment le monologue final, sublime inprovisation de Rutger Hauer, tout en dénuant tout Homme d'une quelconque sensibilité. Sebastian, encore lui, est un bien un bênet total.
Ainsi, le vrai cœur du film serait la perte d'âme, de spiritualité même, dans une société déshumanisée. Ce n'est pas pour rien si la figure de l'oeil est centrale au film: remettant en cause la perception de la réalité, élément majeur du test Voight-Kampff, il s'agit, pour citer Cicéron, du “miroir de l'âme”. Selon cette interprétation, Blade Runner n'est alors peut-être pas si pessimiste qu'il n'y paraît : certes, Deckard est finalement sûrement un réplicant, mais la fin du film montre avant-tout une évasion, puisqu'il refuse de tuer Rachel, un refus du conformisme pour la liberté de l'amour. Les yeux des réplicants ont beau être teintés d'une rougeur qui les démarque, ils renferment ainsi peut-être bien une âme, et plus encore, un espoir: comme ce plan, magnifique, qui résume à merveille ce chef-d'oeuvre, où les flammes apocalyptiques et les pyramides de Tyrell se reflètent dans l'œil, dans le regard.