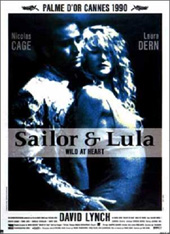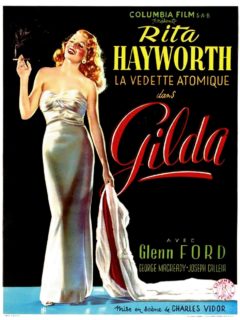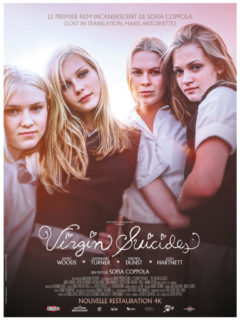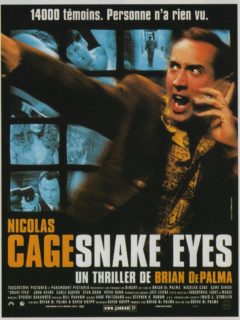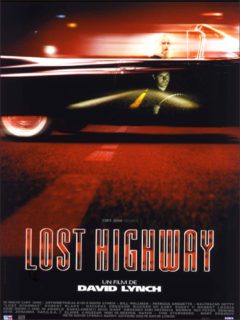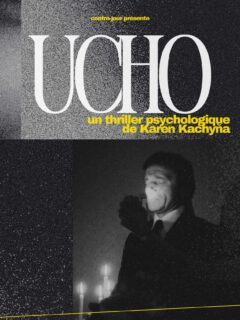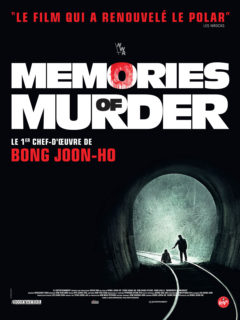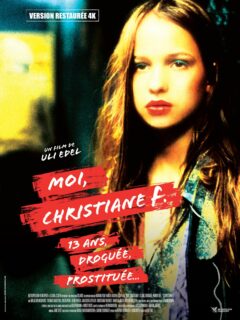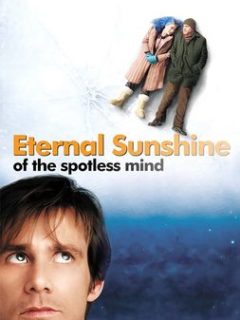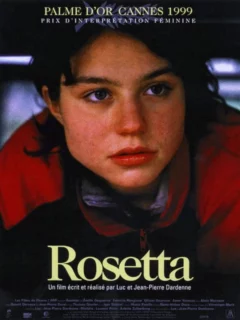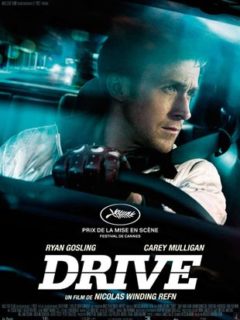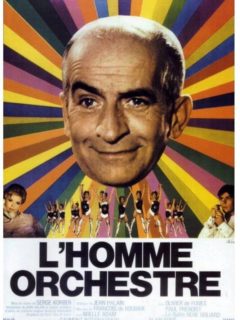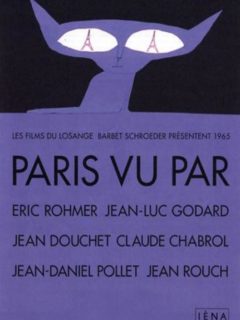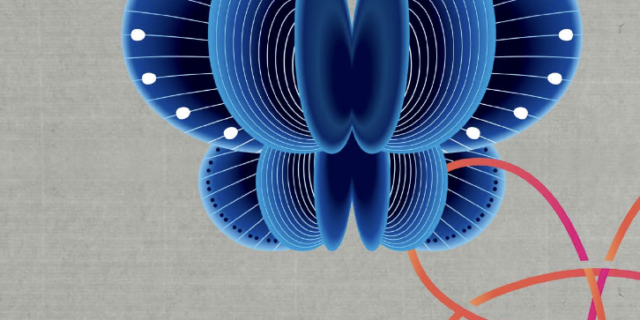Fragments de vie, parcelles de soi (Vivre sa vie (1962) de Jean-Luc Godard)
Profession Reporter
Edition 2022-2023
En 1964 sort Une femme mariée, « Fragments d’un film » : titre révélateur de ce qu’était la filmographie de Jean-Luc Godard dans les années 60 (et dans toute son œuvre en un certain sens). Fragmentaire, oui, faite de véritables pulsions d’images (à l’image de ces jump-cuts, soubresauts cinématographiques), tiraillées entre la tragédie (Le Mépris) et le polar de série B (Bande à part). Des trajectoires parsèment cette décennie, celle d’À bout de souffle, dans son dernier travelling, celle de Pierrot le Fou, mais ce sont des lignes brisées, des fuites perdues d’avance, et, par une explosion, Jean-Paul Belmondo en finit littéralement fragmenté. Au milieu de tout cela, Vivre sa vie est un film-fragment type. En douze « tableaux », le long-métrage suit bien un scénario, mais pas un narratif, il s’achève bien en sommet, mais pas réellement dans une logique d’escalade : il considère son être comme un éclat.
La tautologie, « vivre sa vie », autour de laquelle graviteraient tous ces tableaux, dans la veine godardienne de cette poésie du langage détourné, contient bien en elle-même toute l'essence d'un fractionnement de la vie. Il ne s'agit plus d'une totalité, d'un ensemble physique ou social, « la vie », mais d'une part du tout divisé, la sienne.
Les tableaux font donc d'abord le portrait fracturé d'une vie parmi toutes les autres, entre vagabondage et prostitution, non pas comme symbole, ni comme figure misérabiliste, mais au contraire comme spectatrice de la vie.
Spectatrice littéralement dans la magnifique scène au cinéma (quoique l'on verra que cette scène échappe peut-être à l'inaction du spectateur), puis spectatrice d'un monologue philosophique, d'une fusillade, etc. Même un de ses clients l'instaure en spectatrice lors du dixième tableau : Nana est comme une passante pris entre les feux des vies des autres. C'est la tragédie que filme Godard, non pas une descente aux enfers, car la descente implique irrémédiablement une action, mais une chute autonome, inévitable et déstructurée, dont la victime est elle-même comme témoin de son propre sort.
Ainsi, Nana, qui tout du long proclame sa responsabilité dans ses actions, se retrouve finalement prisonnière d'une spirale dont elle n'a même pas elle-même déclenchée l'issue, aliénée par son rêve de devenir actrice. C'est le huitième tableau qui opère le basculement, s'il y en a un : décrivant méthodiquement le métier de prostituée, la voix-off, didactique, semble comme dominer ses actions, la répétitivité des plans la condamne à une routine infernale. De l'amour vendu il ne reste même plus un plaisir charnel, mais uniquement des chiffres.
« Vivre sa vie » devient alors comme un impossible mantra. Les moments de vie qui constituent le film en dehors de la prostitution du personnage se structurent justement comme des fragments séparés, dont le manque de connexion créé la mélancolie. Du personnage de Nana, il ne reste qu'une ombre, celle de gestes épars, (une danse, des séductions), celle de lieux où l'on stagne (des cafés aux maisons closes en passant par un disquaire), celle des inconnus que l'on fréquente et que l'on oublie.
Éblouissante et inséparable de son personnage au nom anagramme, Anna Karina est alors tout autant un satellite qui sort du cadre aussi vite qu'elle y est rentrée, ne se dévoilant que par bribes.
De la même manière, si Belmondo rapproche la vie au roman dans Pierrot le Fou , ce n'est ainsi peut-être pas pour pointer leur linéarité, mais plutôt la fragmentation simultanée du roman moderne et du soi dans notre « civilisation du cul » : « J'aimerai être unique, j'ai l'impression d'être plusieurs ».
Dans ce morcellement individuel de la vie et cette déstructuration de soi, le langage est vu comme potentiel pont, de soi à l'autre, d'une scène à la prochaine. Mais trop souvent il tombe dans ce que Godard appelle la « langue », c'est-à-dire une communication qui n'est plus phrase mais assemblage de mots, un lien artificiel, un étalage de sens sans émotions. Les émotions, c'est justement ce dont il faut se détacher pour maîtriser son langage selon le philosophe du café : « Je crois qu’on arrive à bien parler que quand on a renoncé à la vie pendant un certain temps ».
Opposée à la langue, l'image est alors forme purifiée de langage : car elle refuse chez Godard toute syntaxe, tout ordre conventionnel ou même moral, elle atteint une liberté totale, à la hauteur de ce qu'elle souhaite exprimer. Thèse qui parcoure l’œuvre de Godard mais trouve ici une fonction indispensable dans ce qu'est « vivre sa vie ». Ne réside-t-il pas dans cette tautologie le paradoxe de vivre une vie comme flux d'images extérieures à soi ? On retrouve la notion de spectateur. Mais surtout il s'agit ici de capter l'essence d'une vie, celle de Nana, et justement de savoir la restituer au spectateur, de l'exprimer par l'image. Mission qui semble perdue d'avance : le premier tableau est un jeu d'ombres, qui renvoie ses personnages à leurs silhouettes inexpressives, vues de dos. Nana nous reste donc inconnue, et le restera tout au long du film. Avec ses paroles, on effleure sa philosophie, mais sans jamais l'atteindre réellement (« Plus on parle plus les mots ne veulent rien dire», dit-elle), de ses actes, on ne captera jamais la pure signification.
Mais cette défaite de l'image n'est qu'apparente, et si la caméra ne rentre jamais en l'esprit du personnage, elle devient vraie spectatrice à part entière, rentrant totalement en osmose avec le milieu qu'elle filme. C'est cette différence qui change également le traitement de la prostitution : pas de regard moral, ni de sujet comme un scientifique contemple un vivarium, mais une vision de l'intérieur du bocal. Cette osmose, c'est la scène de la fusillade, qui interrompt les discussions dans un café, et se traduit à l'image par un panoramique saccadé, comme si l'homme à la caméra sursautait de peur. Cette osmose, c'est la magie de la séquence du cinéma, qui fait succéder, avec un intertitre comme lien, les pleurs d'Anna Karina à ceux de Renée Falconetti, dans La Passion de Jeanne d'Arc (Dreyer). Soudain, dans une telle scène, dans un tel moment de grâce, l'image devient véritablement lien mental: on ne sait toujours rien, ni de Nana ni de la raison véritable de ses larmes, distance brechtienne que maintient Godard, mais l'on se rapproche d'elle, et même de Jeanne d'Arc, elle aussi condamnée à assister impuissante à son procès, par notre statut commun de spectateur. Soudain, le regard devient une véritable action, justement par les pleurs, pulsions vitales qui lient les temps, espaces et existences.
Parenthèse centrale, cette scène ne modifie en rien l'impuissance que subira Nana au long du film, jusqu'à sa mort, mais elle démontre bien à quel point l'image de Godard capte les âmes sans les rencontrer, exactement comme il définit le cinéma, en filmant l'invisible. « Il faut se prêter aux autres et se donner à soi-même » (Montaigne) dit-on à l'ouverture du film : c'est cela le drame de Nana, de s'être trop donnée aux autres, aux spectateurs en tous genres, et pas assez à elle-même, jusqu'à la perte d'un soi, fragmenté, d'une vie, parcellaire.