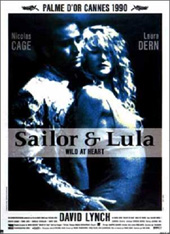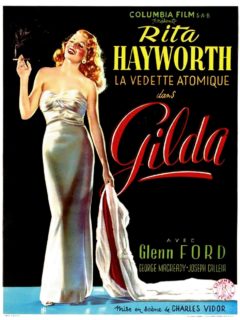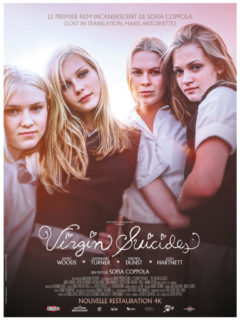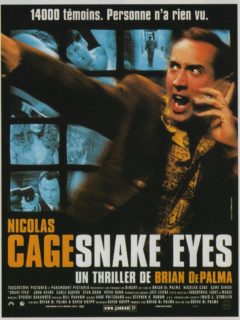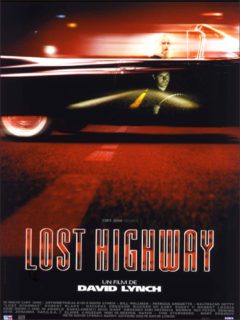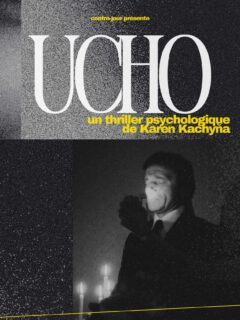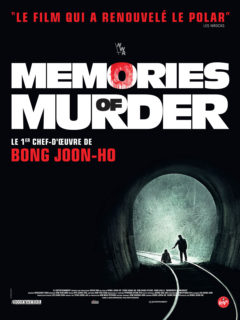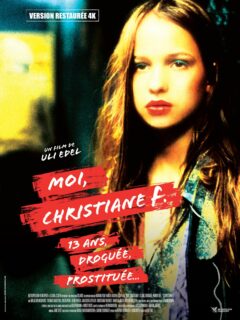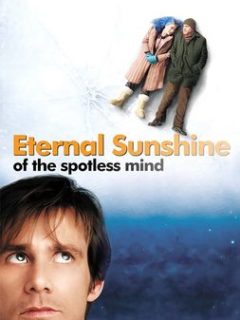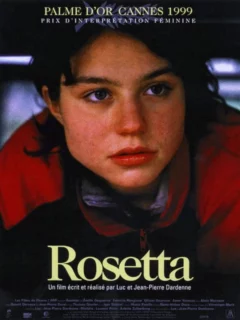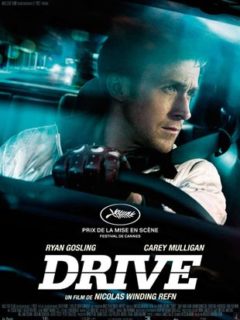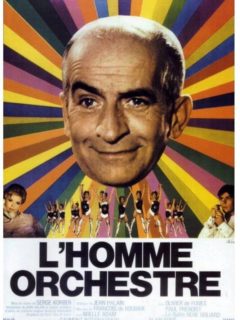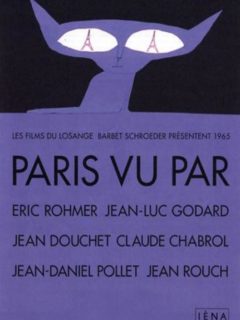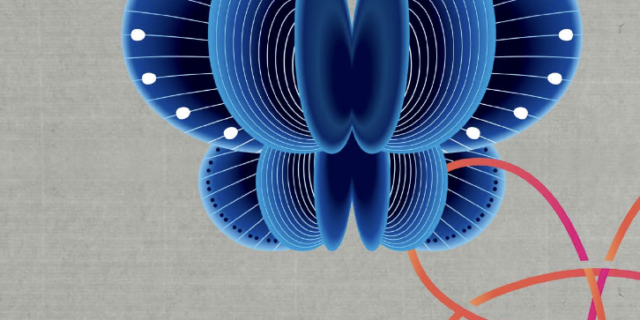Pour une éthique du film noir (J’AI LE DROIT DE VIVRE, Fritz Lang)
Profession Reporter
Édition 2021-2022
Entre Roméo et Juliette et Bonnie et Clyde, le couple que forment Joan et Eddie s’inscrit dans la lignée des amoureux maudits par les on-dit populaires et, pour utiliser un terme anachronique, le tribunal médiatique.
Eddie, voleur multi-récidiviste, est enfin libéré de prison pour bonne conduite. À peine a-t-il le temps de tenter de se réinsérer dans le système social qu’on l’inculpe pour un crime qu’il n’a pas commis. Le seul chemin qu’il peut désormais parcourir est celui qui le mènera à la chaise électrique.
Avec J’ai le droit de vivre, Fritz Lang ne s’intéresse pas tant au système carcéral, à ses conditions de détention et à la corruption ni à la mécanique de l’institution judiciaire, qu’à la performativité des récits de l’imaginaire collectif, véritables malédictions qui entretiennent ce système. La première scène est à ce titre éloquente : un homme vient porter plainte pour le vol systématique de ses pommes organisés par les agents de police en personne. Un gros plan sur deux pyramides de pommes fonctionne comme un petit théâtre de marionnettes qui vient illustrer le récit vivant qu’entreprend le marchand. Le premier plan en contre-plongée sur le palais de justice encadré par ses deux imposants piliers de marbre transforme l’institution judiciaire en scène de théâtre à la grecque où se jouent les tragédies humaines.
Des dialogues explicitement chrétiens qui opposent à une mauvaise âme originelle du criminel un discours sur les conditions sociales du Mal naît en fait une question beaucoup plus subtile que ce faux manichéisme naïf caricaturé : l’homme est victime des circonstances. Autrement dit, ses actes sont interprétés, les faits sont agencés selon des arcs narratifs lisibles par la justice, et surtout par l’imaginaire collectif d’une société nourrie d’histoires de criminels en fuite et qui se délecte de la presse à sensation. Si la critique y a vu Bonnie et Clyde, les deux grands amants criminels, Joan et Eddie préfèrent les contes de fée et le romantisme de Roméo et Juliette : à chacun son genre, dira-t-on.
J’ai le droit de vivre est le troisième film que Lang réalise après M le Maudit qui était son premier film parlant, et le deuxième film de sa période américaine. La révolution esthétique qu’entraîne la prise de son avait déjà mené Lang a un questionnement éthique des possibilités ouvertes par cette technique : la reconnaissance de M est d’abord sonore, un sifflement le trahit. Et si le tribunal populaire de l’ultime scène du film avait raison de le reconnaître coupable, sa barbarie était d’autant plus forte que le groupe d’hommes et de femmes rejouait une scène de procès comme si son déroulement rituel avec ses différentes instances et procédures n’était qu’un rôle à jouer, un déguisement à enfiler pour s’octroyer les pouvoirs de vie et de mort sur un être humain. Les questions du lien que doivent entretenir la morale et la justice sont absolument complexes, mais si l’on devait retenir un nom de l’histoire de la philosophie qui aurait pu inspirer Lang, ce serait celui de son confère prussien Emmanuel Kant pour qui même le pire criminel a le droit à la vie, tout simplement parce qu’il est un être humain. Le titre français, tiré d’une réplique du film et non pas traduit de la version original, en devient alors plus clair : j’ai le droit de vivre, nous avons le droit de vivre. Le film deviendrait-il alors un réquisitoire contre la peine de mort, bien au-delà de la caricature des injustices du système judiciaire ?
Il est surprenant que la grande stylisation du film noir, à savoir les jeux d’ombres et de lumière, de brouillard et d’écran de fumée disparaissent une fois que les amants sont sur la route : l’esthétisation du crime et sa mise en récit pour divertir les foules est intrinsèquement liée à l’institution judiciaire et carcérale et à sa médiatisation. Lang nous dirait-il subtilement que le cinéma devient facilement l’instrument de l’idéologie de l’imaginaire collectif ?
Il tente du moins de mettre à l’épreuve la crédulité du spectateur face à ce qu’il voit : ne lui arrive-til pas de douter d’Eddie, notamment lors de l’excellente scène de braquage où l’identité véritable du voleur n’est jamais révélée. Seuls ses yeux nous apparaissent dans une interstice d’une voiture, puisque tout de suite après, il revêt un masque à gaz alors que la caméra se concentre sur le chapeau volé d’Eddie, qui prend la place de ce masque. Et lorsqu’enfin la caméra parvient sur le visage du braqueur, le masque est déjà enfilé. Le spectateur est alors remis à sa place de spectateur consommateur de divertissement : il lit les tropes du scénario et du montage comme il aimerait qu’ils soient, il veut croire à la culpabilité d’Eddie envers et contre tout. Parce qu’il est comme tout le monde, il est humain, il veut structurer le réel d’arcs narratifs lisibles, quitte à devenir lui-même le barbare qu’il parjure.
Un des premiers films noirs de l’histoire du cinéma mène alors le projet fou de remettre en cause l’idéologie véhiculée par ces films héritiers de la presse à sensation, en se servant de ses formes esthétiques pour établir une éthique du film noir. Alors qu’on reprochait à Lang de ne pas savoir se sortir des exigences clichées d’Hollywood !